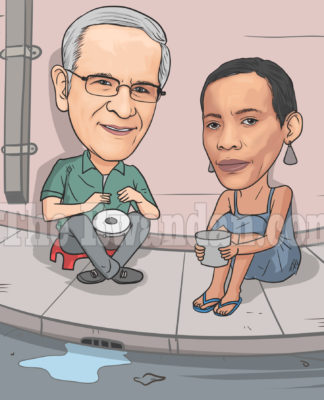(Photo:Pascal Gahamanyi entre sa mère et sa soeur)
Pascal et Pascal, le sauveteur et son protégé, le puissant et le misérable. Drôles de retrouvailles devant la Cour, où le militaire hutu et son petit Tutsi vont s’opposer sans qu’un regard soit échangé. Cette fois, c’est lui, Pascal Gahamanyi, qui tient les rênes face à l’accusé tapi dans son box. L’année 1994 est loin derrière, quand il n’était encore qu’un ado de 18 ans soumis au capitaine et pas ce bonhomme, costaud comme un lutteur, qui parle sans ciller : « Le 8 avril au matin[le surlendemain de l’attentat contre l’avion présidentiel, NDLR], des militaires ont essayé de franchir le portail de notre maison. Mon père et mes deux petits frères se sont enfuis à travers la clôture, moi je suis retourné sur mes pas pour chercher ma mère. Je l’appelais, mais elle n’était pas dans la maison. Les militaires y étaient entrés. Ils m’ont jeté à terre. Trois d’entre eux m’ont mis leurs fusils sur la tempe, un autre me tenait la tête avec ses pieds. Ma mère est arrivée en courant et les a suppliés de me laisser en vie, elle criait ‘Jésus, c’est notre dernier jour, nous sommes entre tes mains !' ».
Ses petits frères, Albert et Michel, ont témoigné juste avant lui. Ce sont eux, les Tutsi que Simbikangwa se targue d’avoir sauvés. Pas une cinquantaine, une poignée. Albert a entendu Pascal Simbikangwa hurler par-dessus la clôture d’épargner cette famille dont le père, bien que Tutsi, travaillait au ministère de l’Intérieur et était sympathisant du parti présidentiel ; dont les trois garçons venaient chez lui regarder la télé ou s’amuser avec sa petite Rutege. « Papa Rutege », comme les enfants l’appelaient, va faire mieux. Il va accepter de les héberger, une chance inouïe. Sauf que Pascal ne voit pas ça ainsi : « Pour moi, c’était l’enfer qui commençait. »

« Il disait : ‘Ces inyenzi, il faut les tuer' »
Le jeune garçon va rester pendant trois mois au côté du capitaine, jusqu’à la fin du génocide, en juillet. Trois mois de terreur, à être constamment menacé par ses deux gardes du corps, qui étaient de ceux qui avaient débarqué chez lui, le 8, pour le braquer.
Quand je suis arrivé chez Simbikangwa, ils m’ont dit qu’ils m’avaient raté, que j’avais eu de la chance et que ce n’était qu’une question de temps : je serais le suivant. J’étais terrorisé chaque fois que je les voyais », raconte-t-il.
« Vous ne vous sentiez pas en sécurité ? » demande le président, Olivier Leurent.
– Non
– Pascal Simbikangwa vous protégeait ou ça pouvait basculer ?
– Je pensais qu’il savait que je me sentais en insécurité. Je n’étais pas en mesure d’aller lui dire tous mes problèmes. » Lui, qui écoutait la RTLM, la bien nommée « radio machette »… « Quand il entendait que le FPR [Front patriotique rwandais, les Tutsi de l’étranger en guerre pour la reconquête du pouvoir, NDLR] avançait, il disait ‘Ces inyenzi, il faut les tuer’. Les inyenzi [infiltrés, cafards, NDLR], c’étaient tous les Tutsi. »
Pendant la sieste du patron, ses gardes s’occupaient : ils sortaient tuer. « Une fois, ils sont rentrés, ils avaient du sang partout sur eux. Comme s’ils revenaient d’une bataille. Ils m’ont bousculé : ‘Voilà le sang des Tutsi, c’est toi le prochain !’ L’un des deux était très très méchant, il essayait de m’attirer dehors la nuit mais je refusais de sortir. Il me demandait si j’avais besoin de son nez pour quitter la ville, si je ne l’enviais pas. Il avait le nez très large. Il a dit qu’un jour mon sang coulerait sur ses mains. »
« Pascal Simbikanwa était-il au courant ? », s’enquiert le président.
– Probablement qu’il l’a su. Il n’a pas eu de réaction.
– Il n’a pas manifesté son désaccord ?, s’étonne le président.
– Pas en ma présence. » Une nuit, ce garde a tué le chauffeur de l’accusé. « Simbikangwa a semblé déçu. Le lendemain, c’est moi qui ai conduit sa voiture. »
« Il n’a pas vu de morts ? Ca m’étonnerait très fort »
Car Pascal n’a pas eu de chance : il avait le visage d’un Tutsi, leur nez fin. Sans parler de sa taille, trop haute. Ses frères cadets font, aujourd’hui, deux têtes de moins ; ils ont hérité de leur mère hutue. Quand, dès le 12 avril, Albert et Michel ont pu grimper dans les voitures pour rejoindre la région de Gisenyi, au nord, Pascal a dû rester chez Simbikangwa, à Kigali. « Personne n’osait me prendre avec lui. Simbikangwa a dit ‘C’est encore trop tôt, il y a beaucoup de tueries, beaucoup de barrières : tu n’iras pas loin.' » Faire monter ce grand ado, c’était s’exposer à des contrôles plus poussés aux barrages que l’accusé se faisait ouvrir sans peine, saluant les Interahamwe d’un « Nous sommes ensemble » en gage de bonjour. « Il les encourageait à ne laisser passer aucun Tutsi », verra plus tard Pascal.
Albert, seul, était du premier voyage avec Simbikangwa, le capitaine invalide sur le siège passager du pick-up et lui derrière, dans la caisse.
« Lors de ce trajet, vous avez évoqué la présence de cadavres. Vous en avez vu beaucoup ? », lui demande l’avocat des parties civiles, maître Emmanuel Dahoud.
– Oui, c’était beaucoup. Des hommes, des femmes.
– Simbikangwa dit qu’il n’a jamais vu de morts, qu’en pensez-vous ? », renchérit maître Simon Foreman.
– Ca m’étonnerait très fort. »

L’avocat de l’accusé, maître Fabrice Epstein, a cette fois un « bon » témoin à questionner :
« Pascal Simbikangwa vous a-t-il sauvé ?
– Oui, il m’a sauvé, répond Albert. Mais j’ai encore vécu deux mois et trois semaines. D’autres personnes m’ont sauvé la vie, deux ou trois fois. » Devant l’insistance du conseil, Albert reste intraitable : « Je ne dis pas que si je vis, c’est grâce à Pascal Simbikangwa. »
« Je n’avais pas le choix », lâche Pascal. Lui, l’aîné, aurait préféré accompagner ses frères et sa mère vers le Nord. Fuir Kigali, plutôt que vivre cette terreur, à tenter d’échapper aux griffes des gardes qui jouaient avec lui comme le chat avec la souris. Mais il a dû rester dans ce quartier de Kiyovu-les-riches quadrillé par les barrières des génocidaires. Durant ces trois longs mois s’est nouée une étrange relation entre l’adolescent et le capitaine. Pascal ne lui confiait pas ses misères, sauf une fois. Lui, l’enfant, parler à cet adulte qui suscitait un respect craintif ? Impossible. Pascal était un protégé qui a vécu comme un otage, un réfugié planqué au cœur du danger, toujours près de se brûler. Pourtant, il le concède, le capitaine Simbikangwa a fait des choses pour lui, comme cette fois où, à un barrage, alors qu’un gardien soupçonnait ce trop grand garçon, il s’est interposé, disant ‘Est-ce que moi, Simbikangwa, je pourrais prendre un inyenzi avec moi ?’ Où il l’a emmené pour retrouver sa mère, en vain. Où il lui a même obtenu une carte d’identité nantie de la précieuse mention « Hutu » en bonne et due forme, passeport pour un futur.
« Il m’a sauvé la vie, mais il pouvait faire mieux »
« Qu’est-ce qui a animé Pascal Simbikangwa ?” se demande le président et toute l’assemblée avec lui.
– Je ne sais pas. C’était pour sauver un petit voisin.
– Ce n’était pas une relation investie sur le plan affectif ?
– Il n’y avait rien entre nous », assène le témoin.
– Vous avez l’impression qu’il s’est donné du mal pour vous sauver ou que ce n’était pas grand-chose pour lui ? », renchérit Maître Simon Foreman.
– Ca ne lui a pas coûté grand-chose.
– Vous lui devez des remerciements ou il a fait le minimum ? »
– Des remerciements, oui, parce qu’il m’a sauvé la vie. Mais il pouvait faire mieux. »
Au fil de ces jours, Pascal a pu observer ce qui se passait chez Simbikangwa. Lui, le petit Tutsi, mué en infiltré malgré lui ! Des choses embarrassantes, il en a vues. Comme ces munitions, « dans des sacs en plastique », et ces fusils, des neufs et des anciens, « entre 40 et 50 », entassés pêle-mêle dans le pick-up du capitaine et qui ont été débarqués avant de repartir, direction Gisenyi. Michel, lui aussi, a raconté les armes, une dizaine de R4 dont les gardes remplissaient méticuleusement les chargeurs. Etait-ce la même fois, était-ce une autre ?
« Comment vous, à 16 ans, parveniez à distinguer un fusil d’un R4 ? », a douté maître Fabrice Epstein.
– Ca faisait quatre ans qu’on était en guerre. Les R4 étaient de nouvelles armes pour remplacer les autres », a répondu Michel.
– Il y a donc un accès facile entre les enfants et les militaires… », a conclu le conseil, éternellement sceptique.
Mais c’est Pascal que, maintenant, l’avocat cuisine.
« Pascal Simbikangwa n’a-t-il pas été un père de substitution pour vous ? »
– Un père ?, s’étonne le témoin, les yeux ronds.
– Il n’a pas joué un peu ce rôle ?
– Non, il a joué un rôle de protecteur, mais pas au niveau de père. »
– Je ressens une certaine colère chez vous », tente de décrypter l’autre conseil de Simbikangwa, maître Alexandra Bourgeot.
– Vous vous trompez, je n’ai pas de colère. »
Il est calme. Jamais, tout au long de l’interrogatoire, Pascal n’aura regardé son sauveteur-geôlier. Ni signe, ni salut de simple politesse. Pascal Simbikangwa, lui, bouille sur sa chaise roulante : quelle ingratitude ! « Je vais bien regretter tout ce que j’ai fait – un devoir d’homme. Le spectacle que nous venons de voir ici est rarissime et pitoyable. J’avais cru avoir sorti cet homme de la tombe plusieurs fois. Malheureusement, je pensais mal. Ce qu’il vient de me faire… » Sa voix se perd, comme toujours il dévie. « Quand ils évoquent ce transport d’armes, Michel et Pascal mentent ? », sourit presque le président, rompu aux réponses de l’accusé. »- Ils ne mentent pas : ils récitent. C’est la stratégie politique des manipulateurs. »
Source:Cécile Deffontaines – Le Nouvel Observateur