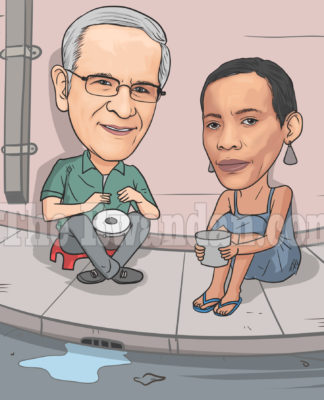C’était un matin comme celui-ci, il y exactement vingt-cinq ans. Nous nous sommes réveillé et avons vaqué à nos occupations comme d’habitude sans nous douter que près de douze heures plus tard, l’avion présidentiel rwandais allait être abattu, une affaire non résolue à ce jour, et que le pays allait être plongé dans une tragédie des plus horribles, tragédie qui allait emporter des millions de personnes et laisser des millions d’autres orphelins, veufs, sans enfants, sans famille et d’autres innombrables, sans pays. Puissent nos proches continuer à Éternellement Reposer en Paix et que les familles et amis des survivants trouvent la paix et une force renouvelée pour continuer le combat de la vie.
Au cours de ces derniers mois, alors que nous approchions de ce satané anniversaire, je me suis retrouvé replongé et immergé malgré moi dans ces jours ineffaçables où nos vies ont changé a jamais. Mais j’ai essayé de me secouer et me suis fait la sotte promesse de me montrer aussi brave que mes compatriotes qui ont subi plus de pertes que je ne pourrais jamais imaginer. Cette année, me suis-je dit, je ne laisserai pas le blues me prendre au piège. Je dois lutter contre les larmes et la tristesse afin de pouvoir rompre avec les maux des vingt-cinq dernières années et me concentrer sur une tache des plus importantes : bâtir les vingt-cinq prochaines années de ma vie.
Dès le début de cet essai des plus inattendus, je dois avouer que je n’ai pas de mots de sagesse à partager sur la manière de faire ce que je viens de dire. Je ne sais même pas si je vais y arriver ou si c’est un leurre que je me suis raconté pour pouvoir faire face aux mois à venir. Ou peut-être est-ce ma façon de demander à mes amis étrangers de me laisser me refugier auprès d’eux afin que je puisse puiser de l’énergie dans votre calme fortitude et votre lucidité avant que le flux incontrôlé de souvenirs n’encombre nos esprits et ne brouille nos discours.
Ce n’est pas si important. Ce qui compte, c’est que nous sommes ici et maintenant et que nous pouvons partager le présent et le passé.
J’avais à peine vingt et un ans au début de la guerre de 1990 et 25 ans lorsque le génocide a eu lieu. J’en ai cinquante maintenant, ce qui fait que ma vie se retrouve aujourd’hui divisée en deux parties égales: 25 ans avant et 25 ans après le génocide.
Je fais partie de cette génération envolée de jeunes qui ont grandi dans l’illusion que, comme nos aînés, nous mènerions une vie normale, avant que la guerre et puis le Génocide ne tuent tout espoir que la normalité refasse jamais partie de notre jargon. Au lieu d’un monde insouciant, 1994 devait être l’année ou nous recevrions cet héritage des plus lourds et des plus malvenus: un pays brisé et rempli de tombes.
Ne me fuyez pas maintenant et ne fermez pas la page de peur que je ne vous plonge dans ces événements d’il y a vingt-cinq ans. Non, rassurez-vous, ce n’est pas pour maintenant ni aujourd’hui. Le voyage que je veux entreprendre avec vous est un voyage de réflexion sur l’héritage des vingt-cinq années qui ont suivi 1994, un héritage que nous allons léguer à notre tour, que nous en ayons conscience ou non, à la jeune génération et aux générations suivantes.
Chaque Rwandais que vous connaissez vous dira que le rétablissement – faute d’un meilleur mot – a été et reste le plus long, plus pénible et plus indésirable chemin que l’homme puisse emprunter. Et la femme et les enfants bien sûr.
Laissez-moi vous dire que même cela est un euphémisme, car aucun mot du dictionnaire ne peut le décrire à juste titre. Imaginez un parcours long de vingt-cinq ans à essayer de donner un sens à l’insensé, à définir l’indéfinissable et à apprendre à accepter cette vérité insupportable que la vie ne sera plus jamais la même. Une longue marche solitaire au milieu d’une foule pressée qui ne vous voit pas.
Alors que notre enfance et jeunesses ont bénéficié de la sagesse que nos parents avaient reçu des générations précédentes, la partie de notre vie post-1994 était un territoire complètement vierge, sans carte et sans recette connue, et sans personne pour nous donner ce genre de réponses toutes faites à toutes les questions qui nous troublaient constamment. C’est ainsi que chacun de nous, des millions d’individus, nous sommes auto-scolarisés dans cette université de la vie si inopportune. Nous étions en même temps les enseignants et les étudiants et ce, sans curriculum pour nous guider. Douteux qu’il y ait eu de l’aide pour nous là-dehors, nous sommes aussi devenus des apprentis thérapeutes et patients, apprenant à nous guérir nous-mêmes de tout traumatisme sans l’aide d’aucun Vade Mecum.
Nous avons échoué et continué à échouer plusieurs fois jusqu’à ce que nous sommes arrivés à nous en sortir et recommencé à vivre, et avec la grâce de Dieu, un jour s’est écoulé et un autre, et avant même de nous en rendre vraiment compte, 9 000 jours et nuits se sont écoulés.
Je ne le dis jamais assez, mais je suis si fier de mes concitoyens rwandais car ce n’était pas facile. Et je sais que le combat de la vie n’est pas fini, que c’est encore difficile pour un trop grand nombre parmi nous, surtout à l’heure où nous entamons une nouvelle période de deuil et que certaines familles ne savent pas encore ce qui est arrivé à leurs proches après 25 ans de séparation. Et je ne peux pas prétendre que mes paroles atténueront le sort des frères et sœurs dispersés dans des pays étrangers, loin de chez eux, vivant la torture quotidienne d’une justice retardée. Néanmoins, le temps nous a prouvé que nous sommes faits d’acier alors que tout nous laissait croire à priori que nous avions été modelés dans de l’argile.
Malgré que j’applaudisse mes frères et sœurs aujourd’hui, je dois être honnête et reconnaître qu’une des plus grandes difficultés de ce voyage a été le fait que nous n’avons jamais été en mesure de nous unir en tant que nation afin de nous tirer mutuellement de ce gouffre sans fond que l’histoire a ouvert sous nos pieds.
Ce n’est pas un seul cheminement que nous avons fait ces derniers 25 ans, mais des millions de voyages parallèles, tous aussi solitaires et inégaux, a la recherche de la survivance de cette tragédie aux dimensions inhumaines.
Ensemble, nous n’étions pas, bien qu’ensemble, nous aurions pu être. Ce qui aurait dû être une entreprise collective ne l’était pas. Là où nous aurions dû compter sur des millions d’autres versions de nous-mêmes pour nous en sortir, nous ne l’avons pas pu. Nos cercles de guérison étaient petits, intimes et remplis de vérités non dites. Malheureusement, ce voyage sans carte et sans méthode ne nous avait pas préparés à nous soutenir mutuellement ou tout du moins aussi adéquatement que nous avions besoin. Nous avons essayé, autant que nous pouvions, mais ce n’était jamais assez.
En disant cela, je ne jette aucune pierre sur qui que ce soit, ce n’est pas non plus un aveu de défaite. Je ne blâme personne non plus pour les voyages en ordre dispersés. Au plus profond de mon propre trauma, je me suis replié sur moi-même et je n’ai été d’aucune aide pour les autres quand je luttais pour reconstruire mon moi tout meurtri. Alors, qui serais-je si je jugeai les autres pour avoir cheminé comme je l’ai fait?
Il me peine également de reconnaitre à quel point des amis d’antan sont devenus si étrangers les uns envers les autres, bien que les experts nous diront certainement un jour que cela est un sous-produit inévitable de tels événements. Lorsque la tragédie a frappé, nous avons prié ensemble, pleuré ensemble et avons fait le deuil ensemble, mais au fil des jours et des années, quand plus de morts se sont ajoutés au compte et que plus d’injustices ont été commises, nous nous sommes progressivement éloignés les uns des autres.
Je n’arrive pas a me souvenir si cela a commencé immédiatement après le Génocide ou si cela a pris plus de temps. Je ne me souviens pas non plus si cela est venu naturellement ou cette séparation a été le fruit de manipulation par autrui.
Ce que je sais, c’est que quelque part, et d’une manière on ne peut plus certaine, nous avons commencé à avoir peur les uns des autres, comme certaines personnes autour de nous devenaient assimilés à la source de nos pertes, comme si nous craignons que certains gens voudraient nous blesser à nouveau, pas physiquement, mais émotionnellement. Alors nous avons construit des murs immatériels tout autour de nous, murs invisibles aux yeux des autres mais on ne peut plus réels, faits de pierres de cristal aux arêtes vives et couverts de fils de verre barbelés, destinés à couper ceux qui oseraint nous approcher avec de mauvaises intentions.
Je sais que ces murs sont réels parce que je m’y suis heurtés tant de fois et je suis tombé sur les pierres qui gisaient à même le sol à chaque fois que j’ai essayé de m’éloigner et de me libérer de mes propres murs.
Vingt-cinq ans plus tard, voilà que je reconnais devant le monde que je suis coincé entre mes murs et ceux construits par d’autres. Appelez ça de l’ironie car j’aime croire que je suis le plus libre des esprits.
Pourquoi est-ce que je parle maintenant et que dis-je? Je dis que 25 ans de séparation, c’est trop long dans une vie.
La peur elle-même est une chose que l’on peut surmonter si nous essayons, mais nos millions de voyages n’ont jamais convergé vers un espace commun où nous pourrions parler à ceux que nous appelons «les autres».
Nos histoires silencieuses n’étaient pas complètement une perte pour tout le monde. Nos murs vierges sont devenus un terreau fertile pour les trop nombreux alarmistes qui ont rapidement comblé le vide laissé par les tyrans d’hier. Un diable semblable aux diables qui parcouraient nos rues il y a une trentaine d’années si ce n’est qu’ils sont plus intelligents ou plus malins – ou du moins ils le pensent. Ils ont inventé de nouveaux vocabulaires ou ont recours à des sous-entendus plus ou moins subtiles pour s’assurer qu’ils peuvent nous parler dans un langage que le monde ne comprendra pas. Retour à la case de départ. Parcourez les nouvelles et commentaires anonymes jalonnant les réseaux sociaux ou écoutez les discours du jour, vous serez édifiés.
Cette haine des jours nouveaux est tellement réelle et si conséquente, et trop d’amis en sont les victimes que cela fait mal. Je ne sais que dire face à cette peine, à part ‘komera’ (soit fort) et ‘bihorere’ (ne leur prête pas d’attention). Mais au fond de moi, je suis révolté de voir que nos propres compatriotes recourent à tous les moyens possibles pour contrôler nos esprits et limiter nos conversations et, malheureusement, ils parviennent à enfermer les autres dans les murs de leurs propres contradictions et de leur propre haine.
Je vois les plus forts d’entre nous réduits à un état constant de peur, peur d’être interrogés, peur de poser des questions, peur d’être jugés pour leurs choix d’amis. Et bien sûr, cette peur odieuse d’être né du mauvais côté de notre crise d’identité caméléonesque. La culpabilité et la victimisation collectives et aléatoires sont devenu monnaie courante, nous nous retrouvons à rejeter insensiblement le chagrin des uns et des autres, manquant de respect pour la perte du proche et blessant les esprits de ceux qui sont partis trop tôt, sont devenues les caractéristiques les plus permanentes et les plus méprisables de l’après-génocide.
Il y a vingt-cinq ans, chaque fois que vous disiez que vous veniez du Rwanda, vous etiez submergés de questions désagréables sur votre appartenance ethnique, un raccourci pour essayer d’assumer ce que vous représentiez sans prendre la peine de vous le demander.
Bien que nos murs immatériels aient été efficaces pour faire cesser ces interrogations, c’était une épée à double tranchant, comme nous le savons maintenant: en érigeant des murs hermétiques autour de nous, nous avons empêché ceux qui ne nous voulaient pas de mal de nous connaitre mieux et de savoir ce qui pouvait nous aider à remonter la pente plus vite.
Quelque part au fil des ans, en l’absence de récits de nos histoires individuelles non racontées, le monde a trouvé réconfort ou refuge dans cet attrayant «récit unique» ou conte de fées d’un pays qui a été capable de se reconstruire et d’avancer malgré son passé.
Les questions difficiles telles que «pourquoi», «comment a-t-on ou» se sont estompées peu à peu, comme si une réponse était trouvée quelque part le long de nos rues et nos jardins refleuris. Les «Oh mon Dieu, je suis horrifié» se sont transformé en «Oh mon Dieu, quel peuple extraordinaire» en l’espace de 25 ans.
Ce n’est pas de leur faute, comment le monde pourrait-il connaître nos histoires si nous ne les leur racontons pas?
Ma promesse ou mon auto-défi pour les vingt-cinq prochaines années est donc de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour mettre la main sur ces histoires et les faire connaître, même si je dois grimper sur les murs de vos angoisses.
Pourquoi maintenant?
Parce qu’aujourd’hui, 25 ans après le Génocide, nous sommes confrontés à une menace plus grande que la peur ou la haine. Maya Angelou a dit qu’il n’y avait pas de plus grande agonie que de porter une histoire non raconée à l’intérieur de sois. Je pense aujourd’hui qu’il y a une plus grande agonie: l’agonie d’oublier cette histoire qui est au fond de vous.
Aujourd’hui, alors que nous sommes confrontés à l’épreuve du temps, nos souvenirs commencent à s’effacer. Nous nous souvenons de nos proches, des détails de leur fin abrupte, mais nous commençons à oublier leurs vies, celles que nous avons vécues ensemble.
Si nous avons appris quelque chose, c’est que le temps est la seule chose qui n’est accordée à aucun de nous. Chaque jour nous rappelle de notre propre mortalité. Il n’y a pas un jour qui passe sans qu’un être cher ne nous quitte, un témoin de ce que nous étions et de ce que nous rêvions de devenir et avec eux, nous perdons un peu plus de nous-mêmes.
Cette année, alors que nous commémorons le 25ème anniversaire du Génocide rwandais, célébrons leurs souvenirs et ouvrons nos cœurs aux millions d’histoires qui n’attendent que d’être racontées.
Contributeur
Um’Khonde Habamenshi