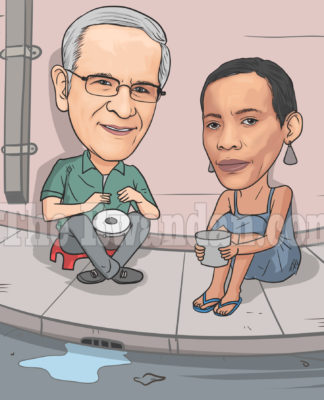Il est presque midi et demi et en ce mois de février, le soleil de Tingi-Tingi brûle encore les corps squelettiques des « fortunés » qui ont marché depuis septembre 1996 à travers d’improbables sentiers de la forêt congolaise. Sur une portion de la route Bukavu – Kisangani aménagée en piste d’atterrissage, une foule curieuse entoure un avion bimoteur à hélices extraordinairement fatigué : un DC 3, également surnommé Dakota ; on l’aurait cru tout droit sorti des scènes de la guerre mondiale sauf qu’ici la guerre était sous-régionale avec, en toile de fond, une implacable et inédite traque de réfugiés. Arrivés sur ce site début décembre, ces derniers étaient invités à s’installer chacun dans sa « préfecture », « commune » et « secteur » d’origine. Plus de 160 000 personnes seront ainsi forcées par les débris de l’armée zaïroise (FAZ) à ne pas franchir la Lubutu, un cours d’eau qui sépare la bourgade du même nom et la localité désormais tristement célèbre de Tingi-Tingi.
Ce 21 février donc, les stations de radio que l’on pouvait capter dans ce village fantomatique perdu au milieu du Maniema rivalisaient à confirmer le caractère éclair de l’offensive que les supplétifs de l’armée rwandaise qu’étaient les militaires de l’Alliance des Kabila avaient entamé 5 mois plus tôt. Villes et villages de l’est tombaient les unes après les autres avec une facilité autant prévisible que déconcertante. Bukavu, Goma, Bunyakiri, Walikale, Musenge, Mubi, Otobora, Chambucha… Toutes des localités sur la route qui mènera la rébellion d’alors aux portes de Kisangani puis à Kinshasa. Sur ce parcours, il y a donc l’étape Tingi-Tingi et plus les hostilités progressent, plus de simple village habité par les Bakumu, le campement se transforme en une grande ville (en fait un mini Rwanda) de bâches blanches qui cachaient très mal la misère, les peurs et angoisses des réfugiés qui s’y abritaient chaque jour par milliers.
Le choléra sévit. Subrepticement. La dysenterie également. Des corps inanimés s’alignent interminablement sur des nattes à même le sol en attente d’un dernier miracle ou tout simplement… d’un enterrement sans cérémonie. La déshydratation endeuille quant à elle les familles qui en sont encore. La faim rend méconnaissables des jeunes qui des semaines seulement auparavant respiraient encore une envie irrésistible de s’extirper de cet enfer. Des mamans sont requises pour généreusement allaiter plusieurs enfants dont on peut malheureusement deviner le sort des parents. Les milliers des blessés par balles claudiquent entre les bâches à la recherche de quelques comprimés de pénicilline ou autres concoctions traditionnelles susceptibles d’alléger leurs douleurs et restaurer l’espoir de reprendre ce qui sera plus tard renommé « la longue marche », en fait un abus de langage ou un euphémisme pour signifier l’indicible calvaire des réfugiés dans la forêt de la RDC.
21 février toujours : la panique atteint des sommets indescriptibles. Avec des récits épouvantables d’horreurs et d’assassinats, les réfugiés rescapés des massacres affluent en provenance d’un autre campement situé à une journée de marche (70 kilomètres) de Tingi-Tingi. La « ville » gonfle, tout comme les colonnes de fumée des foyers bricolés pour improviser des semblants de repas et tromper les estomacs. Personne ne sait ce qu’il convient de faire ; les visages se crispent et la parole devient rare tout d’un coup. Une ambiance lourde de peur. La mort s’annonce et toque déjà à plusieurs cerveaux, plusieurs cœurs et plusieurs sheetings. Personne ne sait si vraiment il y aura un lendemain. La paralysie collective. On s’efforce d’imiter la normalité, rien n’y fait : akuzuye umutima gasesekara ku munwadit-on ; ou plutôt umutima wuzuye amaganya ntusobanura amagambo. Traduction littérale : un cœur chagriné trouve difficilement les mots pour s’exprimer.
Piste de Tingi-Tingi, 16 heures 30, même journée de février : les moteurs du Dakota vrombissent, accroissant de plus belle la curiosité des badauds. Du haut de l’escalier, un homme tient une liste de noms qu’il appellera un à un pour embarquer. Depuis Naïrobi (Kenya), des religieux sensibles au sort de ces gens que les satellites « n’arrivaient pas à localiser » ont affrété des vols charters pour sauver le maximum de gens possible. Jusqu’à 800 dollars américains par tête pour un aller simple. Inabordable à la majorité des réfugiés. Des militaires de la DSP, la fameuse garde rapprochée de Mobutu servent d’agents d’immigration au pied de l’avion et filtrent avec un zèle déplacé les passagers ; en réalité, ils ne faisaient que tamponner leurs passeports après avoir reçu une « enveloppe » des mains de l’équipage. Fidèles à leur réputation de laxisme, ils faisaient plus peur qu’autre chose et, comme à quelque chose malheur est bon, leur indulgence a permis à deux heureux intrus (dont l’auteur de ce témoignage) d’embarquer incognito dans le Dakota, moyennant une dizaine de dollars…
En décollant, le DC 3 a un peu zigzagué, frôlant quasiment le toit d’une des cases des familles kumu. Un peu comme si les airs aussi participaient aux malheurs des réfugiés en refusant un décollage impeccable à ceux d’entre eux qui tentaient de s’arracher cahin-caha à cette malédiction des forêts. Plus l’appareil s’élevait dans le ciel et se perdait dans les nuages, plus une boule au ventre m’empêchait de jubiler : mes pensées n’arrivaient pas à se détacher de tous ceux avec qui j’avais fait ma longue marche. Auront-ils un lendemain ? Subiront-ils eux aussi le sort des milliers dont les corps se décomposaient lentement tout le long de ce chemin de croix ? La réponse vint le premier mars et fut d’une brutalité, d’une cruauté, d’une barbarie et d’une bestialité inimaginable. Tingi-Tingi sera donc bombardé à l’arme lourde puis nettoyé et rasé le plus inhumainement du monde.
Pour tous ceux qui y sont restés, je me souviens.
Qu’ils reposent tous en paix.
Pierre Rugero