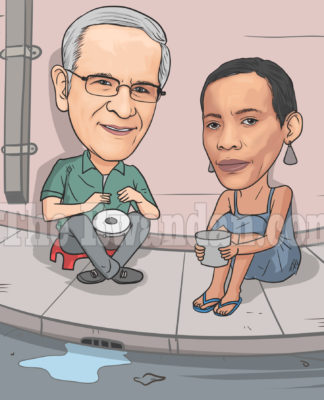En ce moment, je n’ai pas l’intention de réunir les philosophes européens pour m’appuyer, ni pour écrire mon histoire de génocide, simplement je râle sans tabous. Je tiens bien débout et j’ai choisi la date de commémoration que je n’impose à personne vu que chacun a son histoire. Ce que l’on a en commun, ce sont les conséquences et séquelles.
Je ne me sens pas à droite ni au centre ni à gauche. J’ai longtemps cherché le mot qui exprimerait ce que je ressens et je n’en ai pas trouvé. Suite au pullulement des témoignages et témoins, je me sens indignée. Et pourtant, j’ai vécu le drame et les drames connexes. J’ai pu constater que l’histoire de génocide change de face chaque année. Il y a 3 ans, je parlais avec Tatiana une amie qui est née au Burundi où ses parents étaient réfugiés, elle m’a dit qu’elle est arrivée à Kigali en juillet 1994 à 17 ans, elle a pris connaissance avec les filles de son âge, elles sont amies depuis et partagent la joie et peines. Le 7 avril de chaque année depuis 1995, elle écoute avec attention ses amies, elle m’a révélé une chose : chaque année, elle a une version différente et nouvelle. Il est reconnu par les spécialistes que les gens qui ont vécu les événements marquants dans leur vie en donnent des versions qui varient dans le temps, cela s’expliquerait par la prise d’âge, l’association avec ce qu’ils entendent au tour d’eux et leur plus grande capacité de discernement.
C’est sur que la commémoration de cet événement appelle le souvenir des morts, et fait revivre les scènes de désolation. La commémoration laisse un message aux vivants, ce message devrait avoir une mission humanitaire visant à rappeler que rien ne vaut la vie. La mémoire donne une orientation à la vie malgré l’amertume de vivre le passé au présent toujours avec les souvenirs qui font couler les larmes.
Le temps passe, je ne perds pas la boussole, je pense à la dette à l’égard des morts, à l’égard des survivants blessés. Je ne suis pas de l’avis de ceux qui pensent à sacrifier des vies humaines pour prendre le peuple en otage. Je partage mon point de vue, mon statut de survivant me donne le courage et ma conscience me dicte les mots.
Voilà, 23 ans de vie, je ressens la douleur indicible, les années passent, je vis en assistant à une sorte de professionnalisation des identités blessées, pendant ces années, j’ai assisté à une sorte d’intimidation , une vraie sorte de pression qui tend à exiger la masse à vivre les moments de commémoration médiatisés par ceux qui en profitent pour acquérir le statut de libérateurs historiques. On dicte le code de conduite à un peuple meurtri, la commémoration de cet événement servirait à partager un imaginaire pour ceux qui ne l’ont pas vécu. Il n’y a pas de comparaisons de niveaux de souffrances subies, chacun a son histoire pénible et pire.
Personne n’a pu élaborer une échelle de mesure servant à évaluer la souffrance individuelle ou collective.
Au moment où les victimes erraient, les académiciens inconscients se sont réunis pour définir la douleur. Ils ont fini par forger les mots et versions. C’est en ignorant ce que l’être humain ressent face à la douleur. Je ne suis pas indifférente au moment où ma camarade souffre. Ceux qui détiennent le monopole de la mémoire réveille l’amertume, rien n’est pire dans la vie que de se sentir impuissant dans un monde où les tribunaux jugent les vaincus, là où le pouvoir nourrit l’excès et déviations.
Je rends hommage à mon grand-père Médard Ngirumwami et tous ceux qui ont été tués le même jour, je pleure mes tantes, oncles, cousins, Languide, Suzane,… « Iyo mbyibutse ngira akantu »
Survivante et témoin du calvaire de tout un peuple « Qui peut raconter mon histoire sans faillir ni trahir » ?
PS : L’ONU doit s’abstenir.
Vestina Umugwaneza