Pour la seizième fois, je m’en souviens. Les quinze fois précédentes j’ai, comme disent les Belges, mordu sur ma chique ; j’ai fait semblant de ne pas souffrir et j’ai encore caché ma douleur. Bon cœur contre mauvaise fortune. Personne n’a su, vraiment personne. Car il ne m’était tout simplement pas permis d’évoquer la mémoire de tous ces frères et sœurs que j’ai vu tomber comme des mouches à Tingi-Tingi une journée de février 1997. Je n’ai toujours pas ce droit-là ; mais pour cette seizième, je me l’octroie et enfreins volontiers ce contrôle social qui veut cyniquement parcelliser les souffrances. Je fais donc mienne cette phrase de Henri Troyat : « Personne ne saurait en finir. On peut changer de souffrance. On ne peut supprimer la souffrance ». Tant que la mienne sera niée et ceux qui me l’ont infligé canonisés, les esprits de ceux qui sont partis agiteront le sommeil de l’Autre qui passe ses nuits quelque part au Rwanda, de retour d’une divine randonnée interstellaire.
Seize ans donc qu’une étoile guidait des méchants bergers vers les recoins d’une forêt qui m’avait gratuitement offert son hospitalité. Gratuitement ? Presque. Je devais juste respecter quelques règles de précaution : éviter les points d’eau prisés par d’autres hôtes plus prioritaires que moi (les félins), bien choisir ma chambre, donc ma couchette et veiller à la tranquillité de certains voisins (les reptiles), savoir détecter, d’un simple coup d’œil, les champs de tubercules, etc. Non, ce n’était pas Koh Lanta. Les aventuriers de cette émission de télévision passeraient pour des gosses gâteux dans un luxueux bac à sable. Ils ont choisi leur sort, moi pas. Ils ont un médecin à portée de voix, la mienne de voix ne m’attirait que malheur. Ils concourent pour un prix en espèces sonnantes et trébuchantes, mon espoir à moi était de distancer le plus possible l’ahurissant concert fait des crépitements d’armes automatiques ainsi que les vrombissements d’obus divers qui explosaient ça et là. C’était l’enfer. Un de ces inspecteurs des travaux finis est passé par là et osa : how many finally made it out of the forest ? Sans blague !
Pourquoi, avec ses armoiries d’homme blanc et son visa d’humanitaire, il n’a pas posé la question à tous ceux qui l’ont escorté jusque dans ce mausolée? Pourquoi, diantre, n’a-t-il pas jeté un coup d’œil aux innombrables clichés que prenait l’aéronef qui survolait heure par heure mon calvaire ? Pourquoi ? Sa réponse ne m’intéresse plus. Plus aujourd’hui. Seize ans m’ont appris que le principe des vases communicants ne s’applique pas qu’en physique : ce que les puissants de ce monde ont perdu ici, ils s’empressent de le récupérer ailleurs. Ayant donc perdu une partie de leur crédibilité en ne secourant pas mes frères (et mon fils) en 1994, ils ont cru bon de se racheter en offrant des milliers d’autres frères en sacrifice aux instincts vengeurs de quelques soudards qui ont usurpé la souffrance de mon peuple. Sauf que je ne suis pas le seul à m’être trouvé du mauvais côté du canon deux fois, mais ça, dans le raisonnement binaire des fanatiques, des paresseux et autres vendus, n’existe tout simplement pas… En attendant.
Oui, en attendant que les tiroirs des enquêteurs parlent. Que le contenu des rapports qu’on y entassent depuis seize ans soient enfin connu de tous. Je ne saurais en effet me contenter des tergiversations d’un trop timide mapping report. Car les morts étaient ciblés. Une fois, j’ai croisé un kadogo de mon quartier qui m’a apostrophé avec virulence : urajyana he n’ibi bintu ko tugiye kubirimbura ? Je cherchais désespérément un être très cher qui était vulnérable suite à une machette qu’il avait « reçu » deux ans auparavant. Une autre fois, je fus rattrapé par une patrouille de sanguinaires qui avaient des pages avec des noms des personnes qu’ils cherchaient pour, disaient-ils, kubafanyia, c’est-à-dire arranger leurs tronches. Je passe les détails des cruautés qui n’ont d’égal que certaines séquences des films d’horreur. Femmes éventrées ou écartelées, bébés étouffés ou avec des crânes fracassés, vieillards pendus ou crucifiés, jeunes gens dont les yeux avaient été crevés, d’autres enterrés jusqu’à la taille, etc. Vous avez dit enfer ? Seuls d’autres démons – les Interahamwe – y comprendraient mot.
Seize ans donc. Seize infernales années que je revois encore et encore cet afande au teint « noir soudanais » qui nous encercla et qui ordonna à ses hommes de nous aligner à la manière des écoliers. C’est sur la route vers Kisangani, entre Musenge et Itebero. De part et d’autre de la ligne que nous formions, se tiennent des soldats épuisés, mais aux visages hargneux que cachent mal des casquettes insolemment vissés sur des cranes rasés. A l’un de ceux-ci, le « soudanais » fit signe de s’avancer; il s’exécuta et sortit une longue liste de noms qu’il passa quasi sous le nez de chacun d’entre nous avec ces deux ordres : lis et si tu reconnais une personne sur la liste, dis-le. Tous ceux qui ont lu la liste furent mis à part et les autres (dont moi-même) furent escortés jusqu’à un autre groupe beaucoup plus important. A la tombée de la nuit, les vacarmes de détresse, des cris de souffrance et des pleurs d’adieu nous parvenaient du groupe laissé en arrière. Tous massacrés. Parce qu’ils savaient lire… je n’ai eu la vie sauve que parce j’avais égaré mes lunettes et ne pouvait pas déchiffrer les écritures sur cette liste de mort. Il y a seize ans.
Il est donc archifaux et malhonnête de déclarer ces disparus de la forêt « victimes de la guerre ». Ils n’en sont pas. Pour donner du poids à certaines de leurs fables, certains journaleux martèlent souvent le sans appel « j’y étais ». Eh bien, moi aussi j’étais de ce calvaire et je puis attester qu’il était tout sauf une guerre, encore moins une opération de rapatriement. Des personnes de tous les âges ont été massacrés pour qui ils étaient, c’est-à-dire des Hutu. Les dommages collatéraux ont emporté des populations Batiri, Bashi, Bakumu etc. Oui, il y a seize ans quelqu’un avait solennellement annoncé qu’il franchirait la frontière et réglerait leur compte à ces « chiens ». N’ayant pas pu réalisé tout son rêve, il le regretta en confessant n’avoir pas eu le temps de liquider des millions avant qu’ils ne s’exilent…
« Chaque douleur est une mémoire », écrivait Eric Fottorino dans « Un territoire fragile ». Seize ans après, qui donc pour m’empêcher de commémorer (du latin commemoratio) ?
Cécil Kami

















































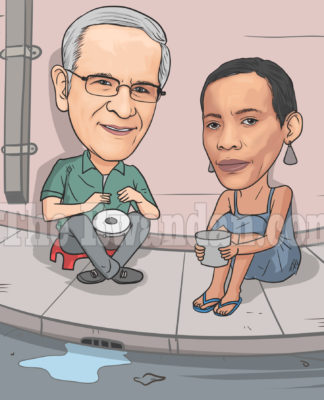










Merci Cecil. L’histoire a pour secret certains boomerangs qu’elle renverra aux criminels au jour venu. Il s’agit pour nous d’être patients et de prier notre Dieu là haut pour que nos voeux de Vérité et de Justice soient exaucés ici-bas et dans l’au-delà. Encore merci et à bientôt.