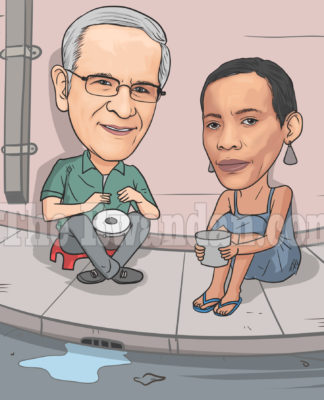Par Ancien ministre des Affaires étrangères
Ce qui a été le plus frappant dans la controverse rwandaise, cela a été l’impossibilité presque totale en France depuis vingt-cinq ans, et encore ce printemps, de débattre et d’évaluer méthodiquement et objectivement la politique française au Rwanda. Peut-être cela va-t-il changer ? Ce n’est pas l’abominable génocide des Tutsis en 1994 lui-même dont il est question : personne ne le nie et aucun article ou livre publiés dans le monde à ce sujet ne le conteste. Il ne s’agit pas non plus de la demande des Congolais de la République Démocratique du Congo de savoir comment qualifier les quelque quatre millions de morts (cf. les estimations du Rapport Mapping de l’ONU et de démographes canadiens) dans l’est de la RDC, au Kivu, entre 1994 et 2003. Non, c’est la politique française elle-même, de 1990 à 1994, et elle seule, qui a fait l’objet d’une dénaturation constante, d’attaques systématiques, et de façon parfois si outrancière (la France complice d’un régime qui préparait un génocide !) qu’il faut essayer de comprendre pourquoi ces accusations ont été lancées et pourquoi certains les ont crues, et relayées.
Rappelons qu’en octobre 1990, la France, sur décision du président Mitterrand, s’est engagée au Rwanda pour empêcher le FPR[1] de renverser le gouvernement hutu de Kigali et de prendre le pouvoir par la force, ce qui aurait inévitablement déclenché des massacres, en faisant en même temps pression sur ce pouvoir hutu majoritaire pour accepter un compromis politique. Par ce double engagement militaire et politique de 1990 à 1993 (y compris sous la cohabitation à partir de mars 1993), la France (Mitterrand, Balladur, Juppé) a rendu possible, comme différents acteurs africains et occidentaux, l’accord d’Arusha conclu à l’été 1993. Accord plutôt favorable aux Tutsis: 40% de l’armée serait revenue au FPR tutsi et il était prévu un gouvernement de transition à base élargie dirigé par l’opposition et réservant cinq ministères au FPR, dont l’Intérieur et le vice-premier ministre, le président de la République se voyant réduit à un rôle de représentation. Après quoi, ayant atteint son objectif, et à la demande du FPR, la France s’est retirée en 1993. Tant qu’elle a été là il n’y pas eu de génocide. L’action de la France a donc conduit au compromis politique d’août 1993. Quand le génocide a eu lieu en 1994, elle n’était plus là. Pourquoi cette vérité élémentaire, et cette chronologie vérifiable, ont-elles été masquées ou niées avec autant de véhémence par tant de médias ou de chercheurs français ?
Le FPR de Kagamé avait commencé au début à accuser la France mais, ayant gagné en 1994, il n’avait plus besoin de ce levier. C’est ainsi qu’en 2001 et en 2002 j’avais pu rencontrer le président rwandais, en tant que ministre des Affaires étrangères, pour parler du Congo. Que s’est-il passé après ?
Aux accusations lancées par le juge Bruguière en 2006 contre le pouvoir de Kigali sur l’attentat, qui, le 6 avril 1994, a abattu l’avion qui transportait les deux présidents burundais et rwandais, le Rwanda avait répliqué en 2008, pour se protéger, par le rapport Mucyo qui accusait la France de « complicité ». C’était de bonne guerre de sa part, si l’on peut dire. Mais pourquoi ces accusations de diversion ont-elles été reprises en France depuis lors, le plus souvent sans aucune retenue, ni contre-expertise, par autant de médias (le plus souvent de « gauche »), de chercheurs, souvent étrangers à l’Afrique, de personnalités ? Alors que ce récit est si peu cru au Congo, en Ouganda ou en Afrique du Sud ? Les procureurs auto-désignés n’ont-ils pas compris le jeu de Kigali ? Est-ce du masochisme ? Certains commentateurs peu informés semblent avoir été atteints d’un « biais cognitif » qui voudrait que la France soit coupable a priori dans sa relation avec l’Afrique, une culpabilité qui rendait superflue une démonstration rigoureuse. Mais, et c’est plus grave sur le plan de l’éthique et de la liberté d’expression, pourquoi tant de médias français, y compris du service public, ont presque systématiquement refusé de donner la parole aux nombreux auteurs de livres et d’articles (Judi Rever, André Guichaoua, Filip Reyntjens, Michela Wrong, Charles Onana, René Lemarchand, Gérard Prunier, entre autres, sans oublier les responsables militaires français) qui, tout en critiquant la France, ne l’accusent jamais de complicité et ne racontent pas le génocide de la même façon que Kigali ? On a accusé ces ouvrages d’être négationnistes. Qui l’a vraiment cru ? Il suffit de les lire pour voir qu’il n’en n’est rien.
En revanche, ils sont « révisionnistes », au bon sens du terme car les auteurs font un véritable travail d’historien en revoyant l’histoire selon Kigali. Une histoire pour le moins tronquée : le FPR de Kagamé n’aurait pas été un parti ethnique tutsi formé en Ouganda, mais un parti démocratique qui serait intervenu pour mettre fin à un génocide ? La légende colportée par Kigali confond ici délibérément 1994 et 1990, une date à laquelle le génocide ne menaçait pas. Les clivages ethniques auraient été inventés par les Belges et les Français ? On croit rêver ! Ce serait bien que l’on écoute des spécialistes de l’Afrique centrale. C’est facile, ils sont peu nombreux. Dans l’Opinion, le 6 août, Stephen Smith, ancien journaliste au Monde et à Libé, a sauvé l’honneur, et mis en avant une enquête de la Britannique Michela Wrong sur les origines africaines du génocide, louée par les plus grands journaux américains (The New York Times, The New York Review of Books, The Washington Post, etc.). Mais Stephen Smith est professeur aux États-Unis. En fait, sauf en France, tant que durera cette exception masochiste et cette auto-intimidation, il est facile de démontrer que la France n’a pas mal agi et qu’elle a fait ce qu’elle a pu (trop seule !), de 1990 à 1993, même si les accords d’Arusha n’ont malheureusement pas été mis en œuvre, ce qui n’est pas de son fait.
Il est clair aussi que la France paye, vingt-cinq ans après, l’absence totale d’explication de sa politique en 1990 (l’engagement militaire et politique), en 1993 (le retrait après les accords d’Arusha) et en 1994 (le retour fin juin, avec Turquoise) et a ainsi prêté le flanc aux interprétations les plus extravagantes et les plus haineuses. Il n’y a pas eu une seule émission ou un seul article sur les accords d’Arusha ! Or ils contredisent toutes les accusations lancées contre l’action de la France de 1990 à 1993. D’où le piège rétrospectif vingt-cinq ans après : une politique honorable, inexpliquée, et inexplicable, vilipendée.
Une analyse objective est-elle possible ? Le remarquable rapport de la commission Quilès/Cazeneuve de 1998, voulue par Lionel Jospin, n’était pas complaisant. Comment qualifier le rapport Duclert de 2021 ? On a constaté que Vincent Duclert – qui s’était dit a priori convaincu de l’implication de la France dans le génocide –, ne pouvant démontrer une complicité (et pour cause) alors que c’est ce qui a été claironné depuis au moins 2008, a affirmé que la France portait une « responsabilité lourde et accablante » – ce que son rapport ne démontre pas, mais que sa conclusion proclame. Quant au discours du président Macron à Kigali, sur la base d’un deal avec Kagamé, il s’est situé sur une ligne de crête très politique : les intentions de la France étaient honorables, Arusha est important, et ce sont des Rwandais qui ont tué des Rwandais – cela a frustré les extrémistes -, mais la France serait lourdement responsable. De quoi ? La vérité historique reste à établir. On peut l’espérer d’enquêteurs belges, anglais, congolais, camerounais, sud-africains et d’experts et de journalistes américains ou anglais. On peut l’espérer aussi de l’ouverture des archives des autres pays, Rwanda compris, si elle a lieu, ce que le président de la République a eu raison de demander.
Il reste qu’une fois écartées les accusations fabriquées de complicité et de responsabilité, des questions peuvent légitimement être posées.
Fallait-il intervenir en 1990 ? Si la France avait laissé se dérouler la guerre civile et les massacres prévisibles, comment aurait-elle expliqué sa non-intervention ?
N’était-ce pas présomptueux de la part de la France, non pas de croire qu’elle pouvait empêcher le changement de pouvoir par la force, ce qu’elle pouvait, tant qu’elle était là, en appui, mais de faire réellement appliquer un accord de compromis entre deux groupes irrémédiablement hostiles ?
Aurait-il été possible pour la France de rester en 1993, après Arusha, en dépit des exigences de Kagamé ? Il aurait fallu un accord des anglo-saxons pour faire pression sur le FPR. Mais à l’époque, ils le soutenaient sans réserve.
Et aurait-il été possible en 1994 d’obtenir plus vite un accord du Conseil de Sécurité pour revenir et mener une opération humanitaire ? Il aurait fallu pour cela tordre le bras des Américains, qui après le désastre en Somalie ne voulaient pas remettre un doigt dans l’engrenage des crises en Afrique.
Toutes ces questions méritent d’être traitées. Ce qui est sûr c’est que la France aurait dû expliquer, de 1990 à 1994, sa politique.
Tout cela milite pour une définition plus rigoureuse à l’avenir des raisons, modalités, et objectifs de toute intervention extérieure, en Afrique ou ailleurs (a fortiori après Kaboul), et d’une explication claire et continue, à chaque étape. Pas besoin pour cela de faire porter à la France une responsabilité fabriquée de toutes pièces.
[1] Organisation d’opposition de Tutsis d’origine rwandaise réfugiés en Ouganda après les massacres des Tutsis à l’indépendance du pays en 1962 lors du départ des Belges, et créée en 1987 en Ouganda pour obtenir leur retour au Rwanda.