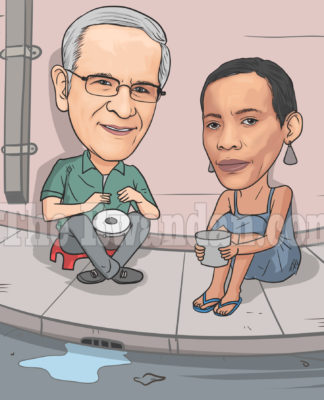Alors que monsieur Poutine a décidé de donner une leçon aux moralisateurs autoproclamés de ce monde (une fois n’est pas coutume), nous devrions tous nous sentir Ukrainiens. Sinon nous sommes du « mauvais côté ». Non. Il y a bien lieu de refuser ce diktat de l’émotion artificiellement créée et entretenue par les journalistes. Voici en effet des lustres que les faits sont systématiquement présentés par certains médias non pas en fonction de leur vraie place dans l’histoire, mais en fonction de l’émotion qu’ils vont susciter. Ainsi donc, puisque la guerre s’est abattue sur les amis d’un Occident arrogant, le monde entier devrait pleurer et condamner la Russie. Les Ukrainiens, ne méritent certes pas du tout ce tapis de bombes, mais avant eux, des milliers de terriens avaient été assassinés sans que les mêmes opinions (aujourd’hui révulsées) ne versent une seule goutte de larme. 1997, quelque part dans les forêts zaïroises…
Vingt-cinq ans après, dans mes oreilles sifflent encore des sons si aigus et si stridents : les sons des sanglots de tous ces anges, tous ces innocents qui ont pleuré jusqu’à perdre la voix pour certains, jusqu’à en mourir pour bien d’autres. Carrément. Le monde des seuls spectateurs autorisés alors à accompagner le drame de Tingi-Tingi – les « experts » occidentaux et leurs « omniscients » journalistes – parlera cyniquement d’enfants non accompagnés. Gravés à jamais dans ma tête, ces sons de l’ultime désespoir me rappellent chaque année, en ce mois de février, la procession de ces mômes qui voyaient le ciel leur tomber sur la tête. Avec leurs grands yeux hagards dans des corps décharnés, ils allaient et venaient dans l’immensité de la forêt tropicale congolaise, ne sachant même pas où aller car, tels des zombies, tous avaient perdu la première boussole que la nature leur avait si généreusement donné : leurs parents. Et ils pleuraient, pleuraient et pleuraient encore.
Ils ne pleuraient pas seulement parce qu’ils avaient faim ces mineurs, non. Ils ne pleuraient pas seulement parce qu’ils étaient fatigués de marcher, non d’errer. Non. Ils ne pleuraient pas parce qu’ils étaient perdus, non ! Savaient-ils seulement qu’ils étaient perdus ? Ils semblaient même ne plus être effrayés par le concert macabre des balles sifflantes et autres bombes qui avaient fauché leurs parents ou leurs tuteurs. Les enfants rescapés des massacres de Tingi-Tingi et d’ailleurs sur le long parcours dit inzira ndende pleuraient parce qu’à leur manière, ces gamins entamaient déjà le deuil de l’humanité. Une humanité que l’on avait enterrée en décidant de démanteler sauvagement les camps des réfugiés du Kivu et en tirant dans le tas sur tous ceux qui s’éloignaient de cette barbarie. Qu’avaient donc fait au monde ces gosses pour être si cruellement traités ? Les pauvres. Ils ignoraient tout simplement que les « grands » avaient résolu d’être, comme dans cette locution latine prêtée au poète Plaute, des loups, les uns pour les autres. Homo homini lupus, paraît-il.
Ces infortunés bambins n’avaient surtout pas eu le temps d’apprendre que leurs aînés, dans une sagesse tout à fait contestable, disent que « Iyo amagara atewe hejuru, buri wese asama aye ». Littéralement, lorsque nos tripes sont balancées en l’air, chacun essaye d’attraper les siennes. Autrement dit, lorsque nos vies sont en danger, chacun essaie de sauver la sienne. Zut ! Et les plus vulnérables, qui s’en soucie, hein ? Pris donc entre cet égoïsme pour la survie et l’impitoyable agressivité plus que humaine des troupes lancées à la chasse du réfugié rwandais, beaucoup d’enfants ont rendu l’âme avant même de mourir. Ceux qui avaient un peu de chance étaient recueillies par des âmes encore sensibles et juste pour un bout de chemin seulement. En attendant l’horreur d’une prochaine embuscade et son lot de cadavres. N’est-ce pas le chanteur Adamo Salvatore qui s’interrogeait dans une de ses chansons en disant : « Y en a qui meurent encore enfants, gagnent-ils au change ? »
Oui, en refermant mes yeux, je revois tous ces corps inanimés étalés à même le sol, à la merci de tous les charognards et dans une indifférence incompréhensible. Enfants et jeunes, adultes et vieux, toutes les catégories étaient là. Rattrapés par le côté sombre de l’âme humaine. Rejetés par leurs semblables. Traqués comme des bêtes par des militaires aux ordres. Débusqués de leurs cachettes pour quelques billets verts. Abandonnés à leur sort par un vide conceptuel nommé « communauté internationale ». Partout dans la forêt, les cadavres étaient présents. De Mugunga ou de Kashusha à Impfondo. En passant par Shanje, Numbi, Nyabibwe, Lumbishi, Chambucha, Hombo, Masisi, Walikale, Otobora, Musenge, Isangi, Mubi, Itebero, Obosango, Amisi, Osso, Tingi-Tingi, Biruwe, Lubutu, etc. En toutes ces localités et plus loin encore, des corps sans sépultures ni pierres tombales qu’on a essayé de cacher dans des charniers pour effacer les traces d’une souffrance. Et putain ! ça a failli marcher.
Sauf que, comme les cris de tous ces enfants mourants, les images de tous ces réfugiés apeurés, affamés, éreintés et puis massacrés par balles ou par baïonnettes, par pendaison ou par noyades, par strangulation ou incendiés, oui ces images, même enfouis dans les entrelignes d’un rapport, lui-même archivé dans je ne sais quels tiroirs, ces images ne s’effaceront jamais. Tout comme la mémoire olfactive de ceux qui sont passés dans les dédales de cette jungle-mouroir au cœur du Congo. L’odeur de la mort, l’odeur des mourants et des morts ne pourra jamais disparaître par quelque décret ou parce que ces morts-là ne comptent pas aux yeux de certains. Ces senteurs provoquent des émotions si bien qu’en un instant l’on peut être plongé dans l’enfer des forêts. Ainsi ces souvenirs s’imposeront-ils toujours à l’esprit de ceux qui ont survécu à Tingi-Tingi. Par respect pour plus de 300.000 personnes qu’un abus de langage désigne comme « portées disparus »… Février est et restera leur mois.
Parlant de « La compassion, de l’affection à l’action » dans Études, 2009/1, Agata Zielinski suggérait : « Si je ne peux « comprendre » autrui absolument, je lui dois en revanche de reconnaître ce qui lui est propre, et donc aussi sa souffrance ».